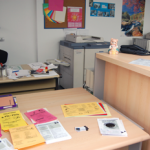Pour optimiser votre mémoire technique et mettre en valeur votre savoir-faire vous travaillez le contenu, vous vous appliquez à suivre nos conseils de personnalisation mais la forme compte aussi.
Pour optimiser votre mémoire technique et mettre en valeur votre savoir-faire vous travaillez le contenu, vous vous appliquez à suivre nos conseils de personnalisation mais la forme compte aussi.
Imaginez que, pour une consultation moyenne de quelques milliers d’euros en BTP, l’administration reçoit une dizaine d’offres. Pour évaluer la valeur technique de chacune d’entre elles, il lui faudra lire les mémoires techniques (certains frôlent la centaine de pages en mode catalogue) et forcément résumer l’essentiel pour entrer dans les critères de choix et présenter un dossier complet lors de la commission de marché.
Si vous ne leur facilitez pas la tâche, vous prenez le risque que vos lecteurs passent à côté du plus important, ne vous comprennent pas bien, ne lisent pas tout.
Par exemple, structurer votre mémoire en parties clairement identifiées et numérotées vous permet d’établir une table des matières avec le renvoi aux numéros de pages et facilite la navigation du lecteur dans votre document. Un mémoire ne se lit pas comme un roman du début à la fin. Le lecteur va en général immédiatement vers ce qui est le plus important pour lui (moyens humains, plannings…) puis revient vers les parties qui lui permettent de comprendre comment vous compter vous y prendre. Ensuite, il reviendra vers certains éléments pour vous attribuer une note pour chaque critère défini. Enfin, en commission, s’il doit justifier ou expliquer certaines choses, il devra pouvoir rapidement se référer à votre document.
Au final, la table des matières lui aura facilité l’analyse de votre offre, lui aura permis d’en avoir une vision claire et synthétique. Il vous en sera donc reconnaissant et, en plus, il sera plus convainquant pour en parler aux décisionnaires.
A lire aussi
Conseils pour la rédaction du mémoire technique
Optimiser la réponse aux appels d’offres publics
Formations pratiques pour la réponse aux appels d’offre publics